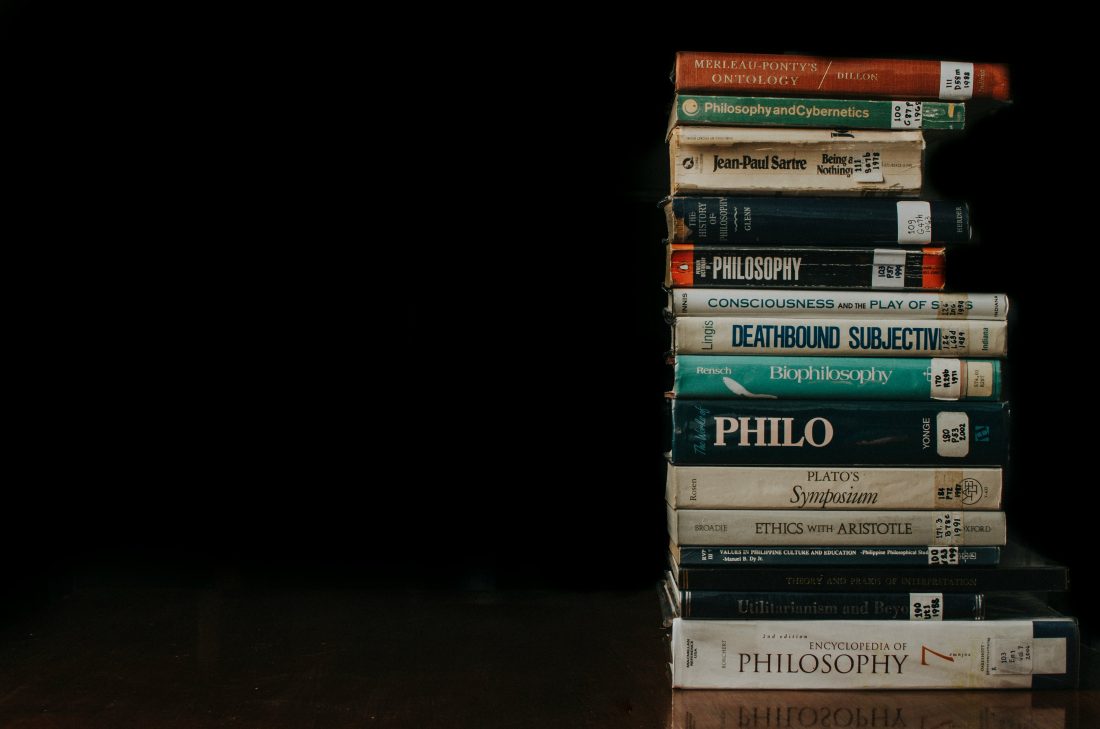Nommer, cadrer, oser : la leçon de Philippe Sands aux pénalistes d’aujourd’hui
Ce que Philippe Sands enseigne encore aux pénalistes
La genèse des deux notions qui structurent depuis Nuremberg le droit pénal international — le génocide (Rafael Lemkin) et les crimes contre l’humanité (Hersch Lauterpacht) — rappelle une vertu cardinale du métier d’avocat : l’inventivité.
Cette histoire n’est pas qu’un récit savant. C’est un mode d’emploi pour notre présent.
Lviv, matrice de deux concepts rivaux et complémentaires
Tout part d’une ville et de deux trajectoires.
À Lviv (ex-Lemberg), Rafael Lemkin forge pendant la guerre l’idée d’un crime visant « l’intention de détruire » un groupe. Il baptise ce concept génocide en 1944, dans Axis Rule in Occupied Europe.
Dans le même espace intellectuel, Hersch Lauterpacht défend une autre voie : protéger la personne en tant que telle, par l’incrimination des crimes contre l’humanité.
Ces deux visions — le groupe chez Lemkin, l’individu chez Lauterpacht — se retrouveront, parfois en tension, à Nuremberg, où s’invente un langage pour nommer l’innommable.
Philippe Sands l’a raconté dans East West Street, devenu en France Retour à Lemberg.
Cette dualité irrigue encore notre pratique : faut-il prouver une politique d’anéantissement (élément intentionnel collectif), ou établir l’accumulation d’atteintes systématiques aux droits fondamentaux d’êtres humains identifiables ?
Il n’y a pas de réponse unique.
Il y a un outillage conceptuel que la défense comme l’accusation doivent manier avec précision.
Du tribunal à la géopolitique : Pinochet, Chagos, Gaza
Sands n’est pas qu’un historien de Nuremberg. Il est aussi un praticien qui déplace les lignes.
Dans l’affaire Pinochet (1998-1999), l’arrêt de la Chambre des Lords ouvre la voie à une responsabilité pénale internationale des anciens chefs d’État pour torture, fissurant le principe d’immunité.
Sands y intervient aux côtés d’ONG comme Human Rights Watch : un moment fondateur du réflexe de juridiction universelle en Europe.
Dans l’affaire des Chagos (CIJ, 2019), il plaide pour l’État mauricien. La Cour estime que la décolonisation de Maurice n’a pas été conduite conformément au droit international. L’épisode montre comment la technique contentieuse peut réordonner des décennies de realpolitik.
Sur Gaza et l’Ukraine, Sands plaide encore pour une lecture universelle des contraintes du droit international : pas d’exceptions d’opportunité, mais un examen méthodique des qualifications disponibles — crimes de guerre, crimes contre l’humanité, parfois génocide — en respectant l’intention, la cible, la proportionnalité.
Sa thèse est simple : laisser la norme travailler, sans totem ni tabou.
Trois leçons pour les pénalistes : nommer, cadrer, oser
Pour un avocat — qu’il défende une personne, une entreprise ou une collectivité —, la leçon de Sands tient en trois verbes : nommer, cadrer, oser.
Nommer
Choisir la bonne catégorie.
Entre harcèlement institutionnel et infractions d’affaires, entre écocide encore « innommé » et atteintes graves à l’environnement, la qualification n’est pas décorative.
Elle détermine la charge de la preuve, le régime probatoire (intention, plan concerté), les immunités et les peines.
L’héritage de Lemkin et Lauterpacht le rappelle : le mot fait le droit.
Cadrer
Maîtriser la procédure.
Dans Pinochet, tout s’est joué sur l’articulation immunités / Convention contre la torture.
Dans Chagos, sur le choix du forum, la preuve historique et l’architecture des actes unilatéraux.
En pénal des affaires ou de l’environnement, le même réflexe s’impose :
- assurer la conservation de la preuve,
- articuler pénal et administratif,
- maîtriser la compétence et la coopération judiciaire.
Oser
Assumer la part créatrice du métier.
La norme n’est pas un plafond, c’est un levier.
Le droit dur naît souvent d’un bon dossier, d’une bonne idée, et d’un juge prêt à écouter.
L’inventivité, loin d’être une entorse, est une responsabilité.
Pénal des affaires, environnement, responsabilités publiques : zones grises, pas zones de non-droit
Dans nos dossiers — fraude, devoir de vigilance, pollution, greenwashing, accidents collectifs — la matière est mouvante : directives européennes récentes, jurisprudences hésitantes, procédures croisées.
L’enseignement de Sands est clair :
- cartographier le flou,
- ne jamais céder sur la rigueur des mots,
- construire une architecture de défense solide, fondée sur les faits, la science, et le droit applicable.
Les modèles de Nuremberg à aujourd’hui offrent une méthode :
partir des faits, puis ajuster la qualification — non l’inverse.
Pour aller plus loin
- Philippe Sands, East West Street / Retour à Lemberg — Lviv, Lemkin, Lauterpacht, Nuremberg : l’atelier d’invention de deux notions cardinales.
- Affaire Pinochet (UKHL 1998-1999) — L’émergence, en Europe, d’une responsabilité pénale internationale des anciens chefs d’État pour torture.
- Affaire des Chagos (CIJ, 2019) — Avis consultatif sur la décolonisation ; plaidoirie de Philippe Sands pour l’État mauricien.
- Analyses sur Gaza et l’Ukraine — La force des catégories pénales et des cadres procéduraux dans les conflits contemporains.
Une leçon de méthode pour la pratique contemporaine
Au-delà de l’érudition, la leçon de Philippe Sands est profondément pratique :
le droit se fabrique au cas par cas.
Aux pénalistes d’aujourd’hui d’assumer cette part d’invention, sans renoncer ni à la rigueur, ni à la mesure.
C’est ainsi qu’on protège le présent, en héritant lucidement du passé.







 Retour aux articles
Retour aux articles